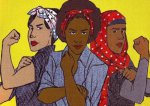Pensez à vous abonner sur notre librairie en ligne, c’est grâce à cela que nous tenons bon !
Penser l’intersectionnalité en éducation ?
Ce colloque avait été longuement préparé par Fanny Gallot, maitresse de conférences en histoire à l’ESPE de Créteil et Lila Belkacem, maitresse de conférence en sociologie à l’Université de Créteil, assistées par un comité d’organisation pluridisciplinaire mobilisant 17 enseignants de l’université de Créteil (sciences de l’éducation, mais aussi histoire, géographie, sociologie, sciences de l’information, STAPS, ainsi qu’une formatrice CAFOC), et accompagnées par un conseil scientifique international de 23 membres.
Qu’appelle-t-on « intersectionnalité » ?
Ce néologisme forgé aux États-Unis dans les années 1980, dans la mouvance du féminisme noir, entendait au départ mettre au centre de la réflexion le caractère complexe des rapports de pouvoir dans lesquels sont prises les femmes noires. Pour ce courant de pensée, « la logique des discriminations est par nature “intersectionnelle”, comme le souligne la philosophe Elsa Dorlin : il n’y a pas d’approche additionnelle, sectorielle, viable —la classe + le “sexe” + la “race”—, la domination est toujours et en même temps un rapport de classe, de genre et de sexualité, de racialisation ».
Ouvrir en ESPE une réflexion autour de cette notion, c’était inviter à réactiver et enrichir de façon ambitieuse la pensée critique des rapports sociaux en matière d’éducation scolaire. Il s’agissait de saisir la complexité des divers rapports de pouvoir dans lesquels sont insérés les individus pour de vrai, – enseignants, élèves, et leurs parents.
Une approche critique
Le colloque s’inscrivait donc en continuité avec la tradition critique en éducation, mais aussi en rupture sur un point essentiel. En effet, lorsqu’une approche critique des rapports sociaux est introduite dans la formation des enseignants, c’est généralement l’approche néo-marxiste héritée de Bourdieu, dite encore « classiste », qui organise le questionnement, autour d’un constat qui porte sur la division sociale des publics et son impact en termes d’inégalités de parcours ou d’orientation, – la « sociologie de la reproduction ».
Or cette approche laisse de côté beaucoup de questions qui surgissent du terrain aujourd’hui, et qui s’expriment en demandes en formation, voire en peurs des jeunes enseignants sur le terrain. Ces peurs touchent à des questions aussi cruciales que la gestion de la classe, la construction de l’autorité, la conception des situations d’apprentissage, la justice de l’évaluation, les sanctions… Et elles prospèrent, il faut bien le dire, sur la timidité avec laquelle les travaux français ont abordé jusqu’ici les questions touchant au sexisme et surtout à l’ethnicisation du social et des rapports scolaires. Les jeunes enseignants ne sont pas formés à ce qui les attend. Cette impasse n’est plus possible, elle est irresponsable lorsqu’on doit former des enseignants dont les premiers postes seront en Seine-Saint-Denis.
Telle était la base de légitimité des journées d’étude de Créteil sur l’intersectionnalité.
Une manifestation maintenue malgré l’adversité
Avant de se dérouler avec un beau succès (trois conférences de cadrage, suivies de 13 panels thématiques et trois ateliers présentant des réalisations), elles ont bien failli être supprimées. Prenant prétexte de l’engagement de certains membres du Conseil scientifique dans le militantisme aux côtés des jeunes issus de l’immigration, tout un éventail de petits mouvements spécialisés dans la défense « laïciste » des institutions républicaines ont lancé des accusations sur internet, dénonçant l’ESPE de Créteil à un moment particulièrement sensible puisqu’on était juste avant le premier tour des élections présidentielles. Les institutions (rectorat, ESPE, Université de Créteil, préfecture) ont paru hésiter, puis ont cédé à la crainte, avant de se raviser. Lors de l’ouverture du colloque, le président de l’université, ainsi que Loïc Vadelorge, historien, directeur du laboratoire ACP qui a fortement soutenu les organisatrices, et Eric Fassin, sociologue Paris 8, ont vigoureusement exprimé leur indignation devant ces attaques sur les franchises universitaires et les exigences de la formation. Mais dans l’affaire, les trente-deux enseignants qui s’étaient inscrits aux journées au titre du PAF, preuve de l’intérêt du sujet pour eux, se sont vus privés de colloque : stage PAF supprimé.

Des apports et des échanges riches
Nous ne saurions résumer ici la richesse des échanges durant ces deux journées qui ont questionné l’institution scolaire au prisme du concept d’intersectionnalité. Treize panels et quatre ateliers, clôturés par une table-ronde, ont permis de mettre en perspective les travaux de chercheurs confirmés, mais aussi de jeunes chercheurs, de formateurs et de praticiens.
Le panel L’institution scolaire fabrique-t-elle un problème musulman ? a fait un retour sur les réactions d’ élèves et d’ enseignants suite aux attentats de Charlie Hebdo dans des écoles ségréguées pour démontrer que la volonté d’imposer de manière autoritaire une lecture républicaine des événements a été contreproductive et a renforcé le sentiment « anti-école » de certains élèves musulmans. Le panel Discipliner les minorés a mis en évidence la façon différenciée dont la « discipline laïque » est interprétée et mise en œuvre dans les établissements secondaires, en ciblant avant tout les filles montrant des signes d’appartenance à l’islam (Chloé Le Meur). On a pu aussi saisir comment les tribunaux pour enfants se prêtent à observer la « modulation du contrôle dont font l’objet les catégories sociales des justiciables » : les garçons des classes populaires racisées sont de loin les plus présents dans la chaîne pénale, à l’exception d’une catégorie de filles, les filles roms (Arthur Vuattoux). Dans l’atelier « La question coloniale », Laurence De Cock s’est livrée à une étude de l’évolution du traitement de la question coloniale dans les programmes, jusqu’à la polémique de 2015, qui a obligé le CSP à revoir sa copie. « Deux questions rendent fou », observe-t-elle, la question de l’islam (vs christianisme) et la question des traites de de l’esclavage (vs les Lumières).
Vers une école inclusive ?
Ce sont des pratiques non discriminantes qui ont été évoquées dans le panel quand les acteurs éducatifs font bouger les lignes. Ainsi a-t-il été question de l’orientation précoce d’élèves vers la MDPH (Maison Départementales des personnes handicapées) et de leur affectation vers les filières ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés) qui révèlent et masquent à la fois des discriminations croisées liées à la classe sociale et aux origines de leur famille ainsi qu’à leur sexe. Même si les Ulis (Unités localisées pour l’inclusion Scolaire) école et collège peuvent apparaître comme de nouvelles filières ségrégatives sous couvert de volonté d’inclusion scolaire d’élèves en situation de handicap, ces nouveaux dispositifs issus de la Loi du 11 février 2005 qui appellent à des pratiques pédagogiques innovantes sont sûrement une opportunité de prévenir le décrochage scolaire et de permettre à des élèves qui bousculent la norme scolaire de se faire quoi qu’il en soit une place à l’école.
Il est apparu que les arts et les pratiques artistiques sont des lieux privilégiés pour travailler de manière non frontale la question des discriminations croisées à l’école et pour susciter l’empowerment des « dominés » : les ateliers dansephilo, ou le théâtre de l’opprimé, d’Augusto Boal en sont des exemples. La pédagogie critique de Paulo Freire avec ses visées de transformations sociales et politiques de l’école, est certainement un des moyens d’amener les enseignants à conscientiser leurs stéréotypes et les discriminations qu’ils mettent en œuvre et à les travailler dans une perspective intersectionnelle. Ce sont d’autres relations aux élèves et au savoir qui doivent être envisagées par la mise en place de pratiques plus coopératives et par une organisation moins verticale.
Former au décryptage des stéréotypes
Espérons que ces journées d’études seront, malgré tous les obstacles rencontrés, le premier jalon pour initier une formation des enseignants visant à la déconstruction des discriminations issues de leurs propres pratiques via les préjugés et les représentations stéréotypées. C’est d’ailleurs ce que préconise de Défenseur des droits dans son rapport du 18 novembre 2016.
Le Défenseur des droits recommande au ministère de l’Éducation nationale de systématiser la formation aux stéréotypes et aux discriminations dans la formation initiale et continue des acteurs de l’École et notamment des enseignants. Il recommande également de donner aux élèves et à leurs familles les moyens de faire des choix éclairés et informés, en luttant contre le défaut d’information, l’autocensure et les stéréotypes, dans le cadre des orientations scolaires.
Evelyne Clavier et Françoise Lorcerie