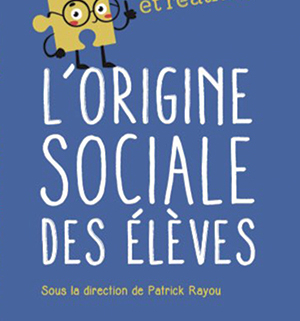Pensez à vous abonner sur notre librairie en ligne, c’est grâce à cela que nous tenons bon !
Le livre du mois du n°558 – L’origine sociale des élèves
S’intéresser à L’origine sociale des élèves, c’est être guetté par deux mythes. L’école de la République aurait tissé au fil de son existence la certitude qu’elle peut tout et, à l’inverse, l’école n’y pourrait rien tant les déterminismes sont implacables.
Deux anecdotes illustrent ce mythe d’une école (Polytechnique !) qui donne sa chance à tout enfant « sans distinction de classe ou de fortune » (p. 4). Mais Élise Tenret rappelle qu’on continue à « donner plus à ceux qui ont déjà beaucoup » (p. 5). La méritocratie et sa communication de bonimenteur inspirent même les Compagnons de l’université nouvelle : « C’est ainsi que l’enseignement démocratique sera en même temps un procédé de sélection. » (p. 13) ! Or, une compétition permanente empêche de privilégier l’intégration et la formation tout au long de la vie. De plus, la religion du programme alimente un « curriculum invisible » favorable aux enfants d’enseignants, mais impénétrable pour qui est étranger à la culture scolaire. Ainsi se crée puis s’alimente le mythe des parents « insuffisamment impliqués » (p. 38). Les recherches prouvent le contraire, mais les « parents [sont] trop peu visibles » (p. 46). Et Agnès van Zanten démonte le faux-semblant des « cordées de la réussite », car les derniers de cordée (tiens !) ne sont que 100 000, alors que 20 % d’élèves en éducation prioritaire, ça fait 2 400 000 ! C’est tout bénéfice pour les grandes écoles en mal de communication et pour certains des « élus » qui les intègrent. Pour les autres, le compte n’y est pas. Ces cache-misères réalimentent le mythe fondateur de la méritocratie.
Est-ce le signe que l’école n’y peut rien ? Le mythe qui voudrait qu’une partie de la population ne pourrait pas accéder aux savoirs a « pour effet de naturaliser les situations, [de boucher] l’horizon d’une action transformatrice » (p. 84). Quelle action ? Patrick Rayou suggère « d’instiller davantage d’esprit de recherche dans [la] formation [des enseignants] » (p. 85). Vincent Dupriez l’illustre par des recherches qui ont établi que l’explication de l’échec par l’origine socioculturelle sert d’alibi. Il puise à trois sources, l’effet établissement, l’effet classe et l’effet maitre surtout. Quelles pratiques pédagogiques pour favoriser les apprentissages de tous les élèves ? Un retour d’informations fréquent sur leurs acquis et leurs marges de progression, un enseignement transmissif et l’accompagnement vers une « posture réflexive » visant le « développement des habiletés métacognitives » (p. 93). Sans oublier « qu’un système éducatif plus égalitaire repose partiellement sur des choix structurels d’organisation » (p. 97). Et il recommande pour la formation « un enseignement [qui] doit être mis en relation avec les situations professionnelles rencontrées par les enseignants » (p. 98). Suivent trois chapitres qui portent sur des zones d’ombre comme l’école rurale, l’accès aux œuvres patrimoniales et le mythe tenace de la docilité des filles et de la violence des garçons.
Ce livre permet de comprendre les origines et la perpétuation de ces deux mythes. D’une lecture aisée, il présente l’avantage d’ébaucher des pistes pour l’action, même s’il hésite parfois entre des références à une équipe de recherche (p. 137) et une proposition plus large, « celle des recherches collaboratives » (p. 139) qui aurait pu être présentée plus haut. Connaitre les mythes dans leurs variations fait découvrir d’autres références pour l’action des personnes, des équipes, des écoles ou des établissements mais aussi des systèmes qui doivent se réorganiser s’ils veulent réellement atteindre le but de démocratisation.
Richard Étienne
Professeur d’université émérite en sciences de l’éducation, université Paul-Valéry, Montpellier 3
Questions à Patrick Rayou

Cette opposition de deux mythes est très significative et bien menée, est-ce lié à la collection ou à un travail collectif du groupe d’auteurs ?
Le propre d’un mythe est qu’on ne peut qu’y croire, pas le prouver ou le réfuter. Il comporte donc en lui-même la possibilité d’affirmer des vérités tout autant que leur contraire. De fait, beaucoup de débats ordinaires sur l’éducation s’inscrivent, au gré de l’humeur des participants ou de leurs engagements politiques, dans un registre plutôt optimiste (« l’école peut tout ») ou plutôt pessimiste (« l’école n’y peut rien »). Quand les éditions Retz m’ont demandé de contribuer à leur collection « Mythes et réalités » sur la question des origines sociales des élèves, je me suis rendu compte que les travaux que je connaissais en la matière déconstruisaient l’un et l’autre points de vue, également insoutenables, car aucune institution n’est toute-puissante ou totalement inefficace. Et, au fond, il y a autant de naïveté à croire que l’unicité des programmes garantit la réussite de tous que de croire que les enfants de milieu populaire seront à jamais insensibles à la culture artistique.
Dans la mesure où les mythes sont insensibles aux démentis, comment s’en déprendre et qui peut aider à le faire ?
Le mythe veut répondre à des questions mais ne pas être lui-même questionné. On ne peut donc, en effet, jamais l’éradiquer par des arguments. Si ce livre tente pourtant de déconstruire quelques mythes sur l’école, il ne peut à lui-même résoudre les questions qu’il essaie d’éclairer. Il me semble que c’est un peu du même ordre que ce qui se passe avec le tabagisme. De façon générale, les fumeurs n’ignorent rien des dangers qu’ils encourent, mais cette connaissance ne suffit généralement pas à leur faire abandonner une pratique qu’ils savent nocive. Les tabacologues, outre l’information qu’ils peuvent leur apporter, tentent aussi de leur montrer que retrouver la saveur des aliments ou pratiquer un sport sans s’essouffler peut leur procurer un plaisir au moins aussi grand que celui auquel ils les appellent à renoncer. C’est donc, pour moi, dans l’action éducative qu’on peut se défaire des mythes et là, l’intérêt des mouvements pédagogiques est grand, car ils aident à nouer ou renouer avec le plaisir de voir par soi-même que le jeu scolaire peut être gagnant-gagnant, pour l’enseignant et pour l’élève.
Une fois mis en évidence les mythes construits autour des origines sociales, quelles pistes d’action concrète peuvent nous apporter les recherches ?
Les recherches en éducation sont par principe frustrantes. Elles-mêmes peuvent d’ailleurs faire l’objet de mythes ! Les chercheurs auraient des réponses qu’ils ne voudraient pas donner, ou, au contraire, ils voudraient que les enseignants suivent leurs préconisations au détriment d’autres, nécessairement erronées. Or, il n’y a évidemment pas de panacée. Ce qui marche avec l’un dans telle situation ne marche pas avec tel autre dans une situation apparemment analogue. Ce qui subsiste en revanche, c’est une manière de problématiser des aspects ordinaires de la vie scolaire qui ne vont jamais de soi pour les élèves dont la socialisation scolaire n’est pas dans le prolongement naturel de celle qu’ils connaissent dans leur famille. Si, par exemple, tous les enfants sont familiers des albums de jeunesse qui circulent entre la maison et l’école, les uns et les autres sont très inégalement préparés à leur traitement lettré en classe. Le savoir peut armer des pratiques pédagogiques qui veillent à ce que les codes scolaires soient accessibles à tous.
La conclusion suggère d’explorer la voie des « recherches collaboratives » (p. 139). Pouvez-vous en donner un exemple ?
Si les recherches sont déconnectées de toute finalité pratique et si les pratiques pédagogiques ne prennent pas de recul sur elles-mêmes, les mythes ont de longs et beaux jours devant eux. On peut espérer que le foisonnement actuel de recherches collaboratives dans lesquelles les chercheurs et les praticiens s’attèlent ensemble à la résolution de difficultés récurrentes participe à l’érosion de quelques mythes qui contribuent à la pérennité des inégalités socioscolaires. Je participe pour ma part en ce moment à une expérience de classes ouvertes aux parents, dans le cadre d’un LEA (lieu d’éducation associé à l’IFE) et il nous semble que la « démission éducative » souvent attribuée aux catégories populaires y est très sérieusement démentie par la venue de parents nombreux, très désireux de voir comment leurs enfants se comportent à l’école. Dans les échanges, ils donnent à voir des éléments de leur éducation, posent des questions qui ébranlent des préjugés que pouvaient avoir les enseignants à leur égard. À l’inverse, plusieurs de ces parents découvrent des difficultés du métier d’enseignant qu’ils ne soupçonnaient pas et font un pas vers la recherche de collaborations pratiques qui aident à sortir de l’immobilisme.
Propos recueillis par Richard Étienne