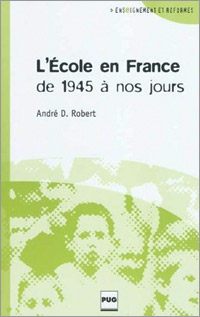Pensez à vous abonner sur notre librairie en ligne, c’est grâce à cela que nous tenons bon !
L’école en France de 1945 à nos jours
André D. Robert est professeur en sciences de l’éducation à l’université Lyon 2, directeur d’école doctorale et du laboratoire Éducation, cultures et politiques. Sa position au carrefour entre enseignement et recherche représente déjà un indice de lecture. Mais ce qui va encore davantage compter dans le type d’écriture, c’est que la spécialité d’André Robert porte sur la sociohistoire de l’éducation. Ses principaux travaux ont porté sur les politiques éducatives et sur les syndicalismes enseignants. Ce dernier livre met en lumière les interactions plus ou moins visibles en leur temps, plus ou moins oubliées, qui ont joué, en coulisses ou sur scène, en soixante ans de politiques scolaires.
L’intérêt de ce livre très fourni est triple. Tout d’abord, il décrit avec la minutie d’un scientifique les étapes et les principaux intervenants des grandes réformes de l’Éducation nationale, depuis le très ambitieux et très porteur d’espérance plan Langevin-Wallon au sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la loi de 2005. On lui accordera ensuite de mettre en lien à postériori les courants qui ont opéré. Et surtout, ce livre apporte, tout au long de son déroulement, des réponses à des questions d’actualité : la démocratisation a-t-elle été réelle ? Ou, interrogation plus récente et conséquente en matière de direction d’établissement par exemple, le néolibéralisme affecte-t-il réellement l’Éducation nationale ? Triple intérêt donc. Trois raisons de se plonger dans ce livre comme on plonge dans ses souvenirs. Pour y retrouver avec satisfaction des faits politiques devenus historiques ou pour y trouver une intelligence globale qui fait défaut souvent lorsque l’on est pris dans les évènements.
Christine Vallin
Questions à André Robert
 |
Qu’est-ce qui d’après vous, dans les décennies passées, a conduit à la mise en place du socle commun ?
La question du socle commun doit évidemment être inscrite dans l’histoire du collège en France, ou de ce qu’ailleurs on appellerait l’école moyenne, cette phase intermédiaire entre la sortie de l’école élémentaire et la fin de la scolarité obligatoire. C’est devenu une banalité de dire que le problème est apparu en lien avec le phénomène de démocratisation affectant le premier cycle du secondaire dans les décennies cinquante et soixante du XXe siècle et que ce problème concerne centralement la pédagogie du collège. Une opposition de conception (et d’intérêts) s’est fait jour entre ceux estimant que cette pédagogie doit s’affirmer d’emblée pleinement secondaire pour tous et ceux considérant que s’impose une pédagogie prolongeant le primaire de manière à ne pas déboussoler une bonne partie des collégiens. Voulant former, l’homme, le travailleur, le citoyen, le plan Langevin-Wallon de 1947 – non appliqué – entendait articuler les aspects collectif et individuel du problème, en concevant une scolarité quasi entièrement commune jusqu’à quinze ans, les différenciations ne survenant qu’ensuite. Les développements ultérieurs (démocratisation quantitative accrue du collège jusqu’à concerner 100 % d’une classe d’âge, manifestation de l’échec scolaire de masse chez des catégories d’élèves socialement situés puis plus récemment ghettoïsation sociogéographique marquée de certains établissements) n’ont fait qu’aiguiser le problème, qui n’avait pas trouvé de solution dans les réformes successives et qui se traduit par une exclusion très alarmante d’une partie de la population scolaire des savoirs de base et des valeurs portées par la communauté nationale. Dans ses intentions, le socle commun vise à apporter une solution à ce problème : il définit ce dont aucun citoyen du XXIe siècle ne peut se passer dans sa vie personnelle, de travailleur et de membre d’une société, il ne fonctionne pas à la compensation des « disciplines » les unes par les autres (récusant ainsi l’idée étroitement scolaire de moyenne), il procède par compétences rencontrant des domaines disciplinaires et ayant donc un caractère transversal ; en cela il induit une nouvelle pédagogie du collège susceptible de concilier les objectifs d’installer en chacun la culture de base indispensable et de permettre évidemment la poursuite de la scolarité ; enfin, en cas de non-possession au terme de la scolarité obligatoire, il ouvre un droit à éducation complémentaire pour l’acquérir.
À quoi peut-on s’attendre pour l’école en prolongeant les perspectives vers le futur ?
Nous sommes avec cette question au carrefour du pessimisme de l’intelligence et de l’optimisme de la volonté. Sur le versant pessimiste, certaines tendances qu’on repère aujourd’hui dans l’institution scolaire prise dans son ensemble dessinent un avenir des plus inquiétants. L’accentuation du consumérisme scolaire et des stratégies des familles les plus dotées culturellement et matériellement conduisent inévitablement à une privatisation du service scolaire, chacun entendant retrouver dans l’école ses propres intérêts au détriment de la considération d’un intérêt général supérieur et, d’une certaine manière, au détriment d’une forme d’universalisme dont l’école a aussi besoin.
Comme je le montre dans mon livre, les percées de la vision du monde néolibérale dans l’école, relayées par les politiques gouvernementales, sont porteuses d’un avenir mortifère, dont l’université semble en quelque sorte le laboratoire. Si l’évaluation des enseignements et de la recherche est bien entendu une nécessité, sa traduction sans la moindre distance critique en culte de la performance, compétition exacerbée, course à la prétendue excellence, illusoirement présentées comme gages de qualité, risque de provoquer des contre-effets désastreux. La notion d’obligation de résultats appliquée à l’ensemble de l’école, à priori acceptable en elle-même et potentiellement favorable aux élèves, notamment les plus faibles, procède en fait de la même orientation compétitive (prendre une bonne place dans les classements internationaux) et recèle ainsi de graves dangers.
Sur le versant optimiste, il existe dans la tradition de l’école à la française, encore heureusement vivace, un potentiel d’engagement pédagogique, un socle de convictions et d’expériences, condensés autour des idéaux de justice et d’égalité des chances qui sont en mesure au moins de résister aux tendances évoquées ci-dessus et de proposer une vision alternative de l’école orientée vers d’autres valeurs, dont on peut espérer que d’autres conditions politiques les feront triompher.
Quelle marge de manœuvre pour les projets de politique éducative en 2012 ?
La question est pour moi : sur quels critères essentiels apprécier un programme (de gauche) pour l’école ? Sans prétention à l’exhaustivité, et outre les objectifs réitérés de lutte contre l’échec, je formule en conclusion de mon ouvrage quelques conditions générales que je considère comme autant de « boussoles ». Les biens scolaires (éducation et instruction) ne doivent en aucun cas, par un biais ou l’autre, apparaitre comme des biens purement marchands, soumis aux seuls impératifs d’un marché et d’une valorisation unilatéralement utilitariste. Les biens scolaires ne peuvent être soumis au diktat contemporain du relativisme généralisé ; pour autant, et sur différents plans, leur universalisme doit être « ouvert », c’est-à-dire ayant intégré une conscience critique de lui-même. L’école à venir doit ménager une place à la personne, au sujet singulier, à la créativité individuelle. Parallèlement, elle doit organiser les conditions pour que s’exprime l’inventivité pédagogique des enseignants, dans l’intérêt toujours considéré des élèves, particulièrement les plus démunis scolairement. Dans ce cadre, une application souplement gérée du socle commun constitue un critère. La culture dispensée à l’école doit devenir désirable pour la totalité des élèves. La confiance accordée à un projet éducatif sera mesurée au moins à l’arrêt des suppressions de postes et, si possible, à leur augmentation à bon escient. Enfin, l’école du socle commun doit incarner dans ses établissements diversité et mixité sociale, non ghettoïsation et séparatisme. De ce point de vue, un rétablissement intelligent de la carte scolaire m’apparait décisif. Une carte scolaire organisée autour des notions de régulation et de liberté relative, élaborant une offre variée et non concurrentielle entre les établissements d’un même bassin, donnant pour cela une information de qualité à toutes les familles, utilisant des indicateurs de mixité sociale et favorisant les établissements qui le font progresser, développant les dispositifs d’aide réelle aux élèves les plus en difficultés.
Propos recueillis par Christine Vallin