
N° 592 – Peut-on inclure sans exclure ?
Où en est-on de l’école inclusive ? De l’inscription du principe dans la loi à son effectivité sur tout le territoire, il y a un long chemin, semé de réticences, de doutes et de contraintes, mais aussi de réussites et de raisons d’y croire. Notre dossier propose un bel exercice d’équilibrisme pour continuer d’avancer.

N° 591 – Organiser le travail de la classe
Comment mettre les élèves en situation d'apprendre ? Il s'agit d'organiser le travail dans la classe, d'aménager l'espace, de scénariser les temps de travail pour créer les conditions des apprentissages. Mais c'est aussi une affaire de régulation en fonction des réactions des élèves, et d'organisation de l'établissement.
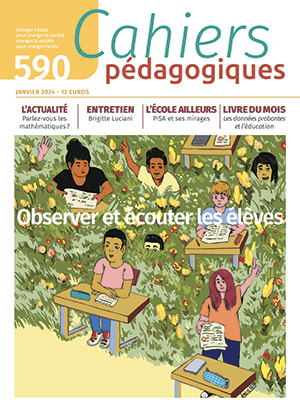
N° 590 – Observer et écouter les élèves
Qu’est-ce qui vaut la peine d’être observé et écouter ? Comment s’y prendre ? À quoi ça sert d’observer et d’écouter les élèves ? Comment apprendre et s’y former ? Ce dossier montre les tâtonnements et les avancées de ceux qui s’y investissent de la maternelle à l’université, et explore les cadres théoriques qui peuvent éclairer leurs choix.

N° 589 – Tu la gères, ta classe ?
Comment « gère » -t-on une classe ? Comment faire vivre et travailler en collectif des enfants ou des adolescents qui n’ont pas choisi d’être ensemble dans cet espace-temps contraint qu’est la classe ? Notre dossier aborde les manières d’accueillir des élèves, d’obtenir et de maintenir une atmosphère de travail sécurisante plutôt que sécuritaire. Une réflexion qui relève donc aussi de l’éthique et du sens que chacun donne aux apprentissages.

N° 588 – Les cultures à l’école
L'école accueille et transmet une grande diversité de cultures. Comment les reconnait-elle ? Comment se passe la rencontre avec l'autre, entre inclusion et tensions ? Notre dossier invite à faire place à l'autre, pour faire société.

N° 587 – Scolaire, non scolaire
Les frontières entre l’école et le « non scolaire » se brouillent. Notre dossier s’attache à définir ce qui est scolaire et ce qui ne l’est pas, alors que l’on apprend dans bien d’autres lieux et circonstances.
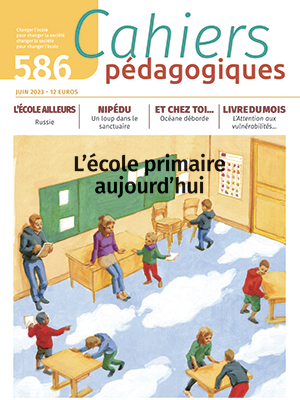
N° 586 – L’école primaire aujourd’hui
Un dossier qui propose l’état de la recherche sur ce niveau scolaire, en dialogue avec les questions professionnelles des enseignants sur le terrain.

N° 585 – Apprendre avec la nature
Les expériences de « classes dehors » ont du succès. Une manière de se reconnecter avec la nature. Mais en quoi le contact avec la nature est-il nécessaire aux élèves, et à quelles conditions permet-il de mieux apprendre ?

N° 584 – À quoi sert le groupe ?
Un groupe, un collectif, une équipe, est-ce la même chose ? À quelle échelle penser l’« effet groupe » ? « Faire groupe » avec une classe, une alchimie indispensable qui aide chacun à se construire.
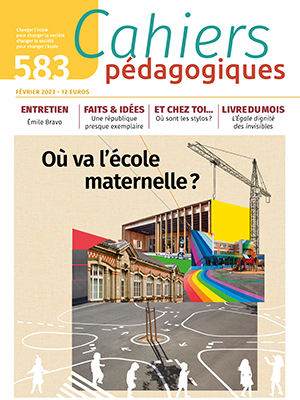
N° 583 – Où va l’école maternelle ?
Dans un contexte de forte pression sur les formes et contenus de la maternelle, quelles valeurs, quels fondamentaux voulons-nous promouvoir ?

N° 582 – L’humour à l’école
Dans un système scolaire construit sur la leçon, la concentration et l’écoute, l’exercice et le travail répétitif, vouloir introduire l’humour peut paraitre provocateur. Pourtant, on peut lui accorder une place dans les apprentissages. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est l’humour et savoir faire avec la dimension fortement culturelle (et interculturelle) de l’humour, y compris dans ses aspects générationnels. Comment apprendre l’humour et avec lui, et quels sont ses effets ?

N° 581 – Qu’est-ce que l’excellence ?
L’excellence, est-ce une passion française ? Que mettons-nous derrière ce terme ? Nous interrogeons la notion d’excellence à l’école, son rapport à l’élitisme et sa place dans le fonctionnement du système éducatif, à travers les pratiques, projets et dispositifs qui s’en réclament.

